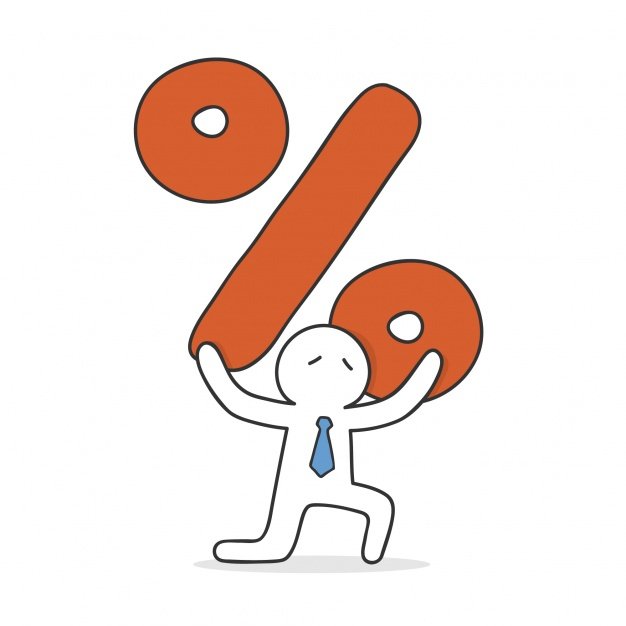
La méthode de valorisation par les multiples est une méthode de valorisation des actions qui consiste à rapporter la valeur d’une entreprise à ses résultats (ou à d’autres soldes intermédiaires de gestion). On s’intéresse généralement aux résultats de l’année en cours ou des deux ou trois années à venir.
Cela permet ensuite de comparer différentes entreprises entre elles, généralement au sein du même secteur. L’approche est différente du DCF (Discounted Cash-flow), qui actualise des flux de trésorerie à l’infini.
Le PER ou P/E
Définition du PER
Le PER (Price Earning Ratio) est l’un des multiples les plus utilisés pour se faire une idée de la valorisation d’une société. Il n’en est pas moins très imparfait, comme on le verra. De quoi s’agit-il?
Comme son nom l’indique, le PER est un rapport entre la valorisation d’une entreprise et ses résultats:
PER= {Price \over \ Earnings} Soit, en bon français:
PER= {Cours\over \ Bénéfices}
Le résultat peut s’interpréter comme le nombre d’années de bénéfices nécessaire pour “rembourser” son investissement initial dans une action, même si cette interprétation est très approximative.
Exemple
Calculons, par exemple, le PER d’une entreprise avec un cours de 100€, qui a prévu de réaliser un résultat net par action de 5€:
PER= {100 \over \ 5} =20Cela signifie que l’entreprise devra faire un bénéfice de 5€ pendant 20 ans pour que je récupère mon investissement initial de 100€. Encore une fois, il s’agit d’une interprétation très approximative, mais c’est l’idée sous-jacente.
PER: Fonctionnement, inconvénients et précautions d’usage
Lorsque l’on utilise le PER, il faut garder en tête un certain nombre d’éléments:
PER et croissance de l’entreprise
Tout d’abord, il faut bien comprendre qu’un PER élevé n’est pas nécessairement signe que le titre est trop cher. Cela peut se justifier par le fait que le chiffre d’affaires – et les résultats – de l’entreprise sont attendus en forte croissance dans les prochaines années. Dans ce cas, la progression des résultats fera mécaniquement baisser le PER dans les années à venir…
Réciproquement, un PER faible ne signifie pas nécessairement que l’action est une aubaine: cela vient peut-être du fait que l’on attend une dégradation des résultats dans les prochaines années.
PER et marges de l’entreprise
Ce point est étroitement lié au point précédent, mais il me semble important de le souligner: la croissance des résultats d’une entreprise peut provenir, soit de la croissance de son chiffre d’affaires, soit d’une amélioration de ses marges.
On voit donc deux types de titres avec des PER élevés:
- Ceux de sociétés positionnées sur des marchés en forte croissance.
- Ceux dont les marges sont temporairement faibles (ou estimées telles)
Ce deuxième cas correspond typiquement aux valeurs dites “cycliques”, c’est-à-dire susceptibles de connaître de fortes variations de marges. C’est le cas des sociétés minières, par exemple, dont le chiffre d’affaires dépend du cours des matières premières, qui connaissent de fortes fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Dans certains cas, même si cela peut paraître contre-intuitif à première vue, il faut acheter ces titres lorsque le PER est élevé, parce que les marges sont sous pression mais s’apprêtent à remonter, et vendre lorsque le PER est faible, parce qu’au contraire, les marges sont au plus haut et vont redescendre.
PER et endettement de l’entreprise
Le PER ne tient pas assez compte de la structure du bilan de l’entreprise.
Un exemple très simple permettra de s’en rendre compte: soit deux entreprises, A et B. Ces deux entreprises évoluent sur le même marché et ont une croissance attendue comparable dans les années à venir. De plus, on attend, pour A comme pour B, un bénéfice de 10€ pour l’année à venir. Leur cours est de 100€. Mais la première dispose d’une trésorerie nette de 50€ par action, et la deuxième n’a ni dette, ni trésorerie.
On a donc:
PER\:A= {100 \over \ 10} =10De même:
PER\:B= {100 \over \ 10} =10Donc, si l’on se contente du PER, on dira qu’il est équivalent d’investir dans A ou dans B… Sauf qu’en achetant A, l’actionnaire investira dans une entreprise qui a 50€ de cash par action en plus…
Imaginons maintenant que A annonce qu’elle va utiliser sa trésorerie pour acheter un de ses concurrents (sur la base d’un PER de 10, là aussi). Du jour au lendemain, ses bénéfices vont progresser de 50% et son PER fondre d’autant…
L’effet de levier
A l’inverse, dans l’environnement actuel de taux faibles, certaines entreprises sont très endettées. Cela pèse modérément sur leurs résultats. Pourtant, cela accroît sensiblement le risque pour l’investisseur, et pas uniquement en cas de hausse des taux d’intérêt. Une fois de plus, prenons un exemple pour comprendre:
Soit une entreprise qui a un chiffre d’affaire de 1000€, des coûts opérationnels de 800€.
Son EBIT ou résultat opérationnel est de 1000-800=200€.
Imaginons que cette entreprise soit lourdement endettée, et paie des frais financiers de 140€. Ces frais sont globalement fixes et indépendants des résultats de l’entreprise. Imaginons aussi qu’elle ait un taux d’imposition de 25%. Son résultat net (RN) est de:
RN = (200-140) – 25% * (200-140) = 45€.
Imaginons maintenant que, pour une raison x ou y, son résultat opérationnel soit 10% moins élevé que prévu (soit 200-200*10%=180€). Alors, son résultat net baisserait dans des proportions bien plus importantes:
RN = (180 -140) – 25% * (180-140) = 30€.
La baisse du RN est de 33%, soit plus de 3 fois plus que la baisse du résultat opérationnel. Tel n’aurait pas été le cas si l’entreprise n’avait pas été endettée. Cela s’explique simplement par le fait que les frais financiers sont fixes dans cet exemple.
PER et cash-flow
Ce qui revient réellement à l’actionnaire, ce sont le flux de trésorerie de l’entreprise (ce qui “rentre dans la caisse”), pas ses résultats: les fameux cash-flows.
Or, les flux de trésorerie peuvent être très différents du résultat net de l’entreprise, dans certains cas. C’est souvent le cas pour les entreprises en forte croissance: pour financer cette croissance, elles ont besoin de beaucoup de liquidités. Cela se produit lorsque leurs clients paient avec un certain délai (variation du Besoin en Fond de Roulement), ou lorsqu’elles doivent investir dans leur appareil de production, par exemple.
Encore une fois, un petit exemple:
Imaginons une entreprise qui a des machines qu’il faudra bientôt remplacer. Ces machines ont une durée de vie longue, par exemple 20 ans. Elles sont amorties linéairement, soit 5% par an. Cela signifie que, chaque année, elles viendront en diminution du résultat net à hauteur de 5%. Mais cette charge ne se traduira par aucune entrée ou sortie de trésorerie. Elle n’appauvrira donc pas l’actionnaire. En revanche, l’année où il faudra remplacer ces machines, le flux généré par l’activité risque d’être fortement négatif…
Les autres multiples
VE/EBIT
Ce multiple présente l’avantage de prendre en compte l’endettement de l’entreprise. Il résout donc l’une des faiblesses du PER (cf. ci-dessus).
Rappel: l’EBIT ou Earnings Before Interest and Taxes, est un solde intermédiaire du compte de résultats, qui correspond au résultat opérationnel, également appelé résultat d’exploitation.
Par VE, on entend Valeur de l’Entreprise (ou EV, pour Enterprise Value, en anglais), c’est-à-dire la somme de la valeur des capitaux propres (la part des actionnaires) et de la dette nette.
Il s’agit donc, dans le même esprit que pour le PER, de comparer les résultats que génère l’entreprise à la valeur des fonds qui ont dû être investis pour financer cette entreprise (par les actionnaires et les banques).
VE/EBITDA et VE/CA
Dans certains cas, on remonte encore dans les soldes intermédiaires de gestion pour comparer la valeur d’entreprise à l’EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) ou au CA (chiffre d’affaires).
Cela se justifie notamment lorsque les marges de l’entreprise fluctuent fortement: ces multiples offrent une plus grande stabilité.
Les multiples de cash-flow
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, ce qui revient vraiment à l’actionnaire, au final, c’est le flux de trésorerie – ou cash-flow – généré par l’entreprise. C’est la raison pour laquelle on utilise des multiples de cash-flow, et non pas uniquement des multiples reposant sur un solde intermédiaire de gestion du compte de résultats.
On entend généralement parler de P/FCF (Price / Free Cash Flow) ou de FCF yield:
Le ratio du Prix / FCF se comprend comme le nombre d’années de free cash flows nécessaires pour rembourser un investissement dans le titre. C’est, en quelque sorte, l’équivalent « cash » du PER.
FCF yield = FCF/P = “rendement” du titre, généralement exprimé en pourcentage. Par exemple, un FCF Yield de 5% signifie que mon investissement dans cette entreprise rapporte du 5%.
Ces deux mesures sont donc strictement équivalentes: FCF yield = 1 / (P/FCF). L’une est l’inverse de l’autre, tout simplement.
Un point auquel il faut faire attention lorsque l’on se sert de ces multiples, est que les variations de trésorerie peuvent être affectées par des éléments exceptionnels, comme une variation anormalement forte du BFR (dans un sens ou dans un autre), des investissements exceptionnellement faibles ou élevés, etc… C’est la raison pour laquelle il est important d’essayer de se faire une idée du FCF normatif de cette entreprise.
Conclusion
Il existe un grand nombre de multiples. Il est difficile de recommander d’en utiliser systématiquement un au détriment des autres. En fonction du contexte spécifique de telle ou telle entreprise, certains multiples seront plus intéressants que d’autres. Le tout est de bien les comprendre et de savoir les interpréter.



